Rouille noire
Puccinia graminis
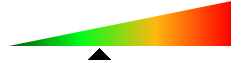
Fréquence


Symptômes
Les attaques de rouille noire concernent l’ensemble de la parcelle mais avec des intensités variables selon son exposition.
- Présence de pustules de couleur brune sur les tiges et parfois sur feuilles, comme sur les tiges, les pustules à urédospores sont plus longues que celles de la rouille brune.Ces urédosores pouvant atteindre 10 à 12 mm contiennent des spores qui sont emportées par le vent et peuvent se répandre sur de grandes distances.
- L’infection des glumes et des arêtes est également possible avec présence de pustules.
- A maturité, sur les tiges et les gaines se développent des pustules allongées de couleur noire sporulées qui contiennent les téleutospores, chargées d’assurer la conservation de la maladie et d’initier sa reproduction sexuée au printemps. Les pustules à urédospores ou à téleutospores sont donc simultanément présentes en fonction du stade de la rouille noire.
- L’épiderme finit par se rompre de façon irrégulière et prend alors un aspect déchiqueté avec apparition de lambeaux rendant « rugueuse » la surface des gaines foliaires.
Biologie
Comme les autres rouilles des céréales, la rouille noire causée par le champignon Puccinia graminis f. sp. tritici est un parasite obligatoire qui a besoin de se maintenir sur des plantes vivantes avec l’hôte principal pour sa survie et parfois avec l’hôte secondaire pour sa reproduction.
La rouille noire se développe à des températures beaucoup plus élevées que les autres rouilles du blé, entre 20 et 30 °C la journée et entre 15 et 20°C la nuit. Les spores ont besoin d’eau libre (rosée, pluie ou eau d’irrigation) et mettent jusqu’à six heures pour infecter la plante.
Les pustules peuvent être observées 10 à 20 jours après l’infection.
Puccinia graminis se conserve sous forme de téleutospores sur les débris de céréales infectées. Au printemps, ces spores vont germer et produire des basidiospores.
Celles-ci sont transportées par l’air sur de longues distances sur un hôte secondaire totalement différent, l’épine-vinette (Berberis spp.). L’infection de l’hôte secondaire conduit à la production d’écidies. Les écidies produisent une nouvelle sorte de spores : les écidiospores, capables de se propager et de réinfecter la céréale hôte. Cette infection produit des pustules noires à urédospores, qui vont se multiplier en particulier sur la tige du blé.
Actuellement, il n’y a pas de nuisibilité en France contrairement à des pays d’Afrique de l’Est et du Moyen Orient où la rouille noire est responsable d’importantes pertes de rendement et a pu engendrer des risques de famine.

Situations à risque
Il y a relativement peu de danger pour la France, même si un inoculum endémique est présent.
La précocité des variétés actuelles permet de finir le cycle végétatif des blés avant l’apparition des conditions climatiques favorables à la rouille noire (fortement exigeante en température). Ce paramètre représente probablement la meilleure protection des céréales d’hiver vis-à-vis de la rouille noire, sous nos latitudes.
Toutefois, en France, le risque n’est pas entièrement nul si l’on cumule tous les facteurs de risque : semis tardifs, maturité tardive, séquence météorologique particulièrement chaude, dans un contexte de réchauffement climatique.



